 |
▲Monsieur
Jérémie Benoît
©NAKAMURA Yutaka |
|
 |
Maison
des Musées de France (MMF) : L'exposition Napoléon
et Versailles qui se tient en ce moment au Japon fait
suite à celle de 2002-2003 qui présentait
l'âge d'or du château de Versailles sous les
règnes successifs de Louis XIV, Louis XV et Louis
XVI. Cette nouvelle exposition vise à présenter
les changements artistiques survenus au sein de ce complexe
architectural sous le règne de Napoléon
Bonaparte. Les périodes du Consulat et de l'Empire,
sans doute encore peu connues au Japon, suivent la Révolution
française. Quelles furent les évolutions
importantes introduites à Versailles après
la Révolution française, sous l'influence
de Napoléon en particulier ? |
| Monsieur Jérémie Benoît
(J.B.) : La première exposition couvrait la période
précédente, de Louis XIV à Louis
XVI, considérée comme la plus éblouissante
pour l'aménagement du château Versailles. |
| Nous avons voulu prolonger
celle-ci en présentant ce qui se passa après
la Révolution, pendant le Consulat et l'Empire,
quand Napoléon obtint la jouissance de cette demeure.
Napoléon avait notamment de grands projets de réaménagement
du château. Ils portaient aussi bien sur l'architecture
que sur la décoration intérieure. Son ambition
était de transformer ce lieu, symbole du pouvoir
royal, en une demeure impériale. Il ne réalisa
pas tous les travaux par manque de temps et d'argent. |
 |
 |
 |
▲Robert
LEFÉVRE
L'impératrice Marie-Louise 1814(huile sur
toile)
©Jean-Marc Manaï,
Château de Versailles |
|
| En définitive, les interventions
de la période impériale se limitèrent
à quelques bâtiments : le Grand Trianon,
le Petit Trianon et le Hameau. Il fit remeubler complètement
le Grand Trianon qui devint sa résidence de campagne
et qu'il occupa après son mariage avec Marie-Louise
en 1810. Aujourd'hui encore, nous pouvons admirer ce mobilier
in situ. Quant aux peintures qu'il commanda, elles sont
exposées désormais dans le musée
du château. Le Petit Trianon fut également
décoré avec un nouveau mobilier pour l'usage
de Marie-Louise. Celui-ci se changea donc en un nouveau
« château de femmes » qui prolongeait
ainsi une tradition née avec Marie-Antoinette. |
| |
 |
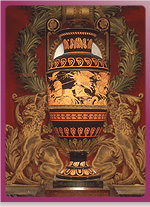 |
▲Manufacture
impériale de Sévres
©Jean-Marc Manaï,
Château de Versailles |
|
 |
MMF
: Pourriez-vous nous indiquer les caractéristiques
du style Empire ? Qu'est-ce qui le distingue du style
précédent ?
J.B. : Le « style Empire » prit effectivement
la suite du mobilier Louis XVI, appelé aussi néoclassique.
Autant le mobilier Louis XVI utilisait des motifs antiques
avec une volonté décorative sur des formes
héritées du XVIIIe siècle, autant
le style Empire préférait copier les modèles
antiques. Ce mobilier présente un aspect plus simple,
moins sculpté. En revanche, il utilise beaucoup
le placage de bronze doré sur des formes simples,
en sorte d'obtenir des formes décoratives nouvelles. |
Le « style Empire » possède
une certaine ambiguïté. Ce terme ne signifie
pas grand-chose en définitive. Plusieurs influences
sont visibles dans cette nouvelle décoration :
une première provenant des modèles antiques
copiés, à partir d'exemples retrouvés
ou non lors de fouilles, comme à Pompéi
par exemple (trépied, trône de marbre) ;
une seconde née de l'accession au pouvoir après
la Révolution d'une nouvelle frange de la population,
la bourgeoisie, avec ses goûts propres.
La bourgeoisie recherchait le confort. Cela s'exprime
par l'invention de meubles complètement capitonnés,
recouverts de soieries qui font disparaître presque
totalement le bois. Cette tendance annonce d'une certaine
manière le style qui se développera sous
le Second Empire et à la fin du XIXe siècle. |
| |
MMF
: Selon quelles modalités les références
à l'antique changèrent-elles sous le Premier
Empire ?
J.B. : Sous Louis XVI, l'antique fut surtout une mode.
Avec la Révolution française et ses prolongements,
le Consulat et l'Empire, les références
à l'antique prirent une connotation différente
en raison de la volonté du pouvoir de se référer
aux anciennes institutions grecques et romaines. |
 |
 |
 |
▲Salon au
Grand Trianon
©NAKAMURA Yutaka |
|
| Cette période se réclamait
volontairement de ce passé glorieux. On peut d'ailleurs
noter un changement de style entre le moment o? Napoléon
Bonaparte était premier consul et celui o? il devint
l'Empereur des Français. Alors que la décoration
sous le Consulat était encore dominée par
des références à l'art étrusque
et grec, celle qui s'élabore à partir de
1805, avec la mise en place de l'Empire, donne plus de
place au luxe des matériaux (réalisation
de camées, utilisation du marbre), à une
certaine opulence qui s'éloigne de la « vertu
». Cette « vertu » était à
l'époque comprise comme une certaine rigidité
ou retenue qui aurait été le propre des
républiques romaines et grecques. Les mentalités
étaient vraiment imprégnées de ces
exemples illustres. Au contraire, la bourgeoisie moins
férue d'antiquité préférait
le confort. Finalement, c'est son goût qui s'imposera
par la suite quand les références à
l'antique seront abandonnées. |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
▲Jacques-Louis
DAVID
Bonaparte franchissant les Alpes au Grand-Saint-Bernard,
20 mai 1800(huile sur toile)
©NAKAMURA Yutaka |
|
 |
MMF
: Ces deux tendances — les références
à l'antiquité et le besoin de confort —
apparurent-elles simultanément ou bien successivement
?
J.B. : Elles apparurent en même temps sous l'Empire.
Beaucoup d'objets présentés à l'exposition
proviennent des petits appartements de l'Empereur et illustrent
bien cette recherche antiquisante secondée par
une volonté de confort. La reconstitution à
l'exposition du salon au Grand Trianon en est un exemple. |
| Elle montre comment l'Empereur, malgré
sa fonction, possédait un goût assez simple
et orienté vers la recherche du confort. Ce mobilier
nous renvoie à la personnalité privée
de l'Empereur, éprise de confort et de tranquillit?,
alors que nous sommes habitués au personnage public
soutenant un style grandiloquent d'inspiration romaine. |
| |
MMF
: Peu de peintres étaient autorisés à
représenter la personne de l'Empereur. Que pensez-vous
des peintres de cette époque, en particulier de
leur relation à la figure de Napoléon ?
J.B. : Le premier peintre de l'Empereur était David.
Un des plus grands portraitistes du temps, Gérard,
son élève, pouvait également représenter
l'Empereur. Il exécuta les principaux portraits
de l'Empereur en grand costume du sacre. Il y eut d'autres
peintres autorisés à peindre l'Empereur
dans ce costume : Ingres, Girodet, Robert Lefèvre.
Comme Napoléon était militaire, simple,
voire un peu rustre, il ne souhaitait pas se soumettre
à des séances de pose. Il ne faisait donc
qu'autoriser la présence à ses côtés
d'artistes. Ils devaient par conséquent posséder
un très grand talent pour saisir sur le vif les
traits d'un homme aussi actif. |
 |
 |
 |
▲François
GÉARD
L'empereur Napoléon 1er en costume de sacre(huile
sur toile)
©Jean-Marc Manaï,
Château de Versailles |
|
 |
▲Col et
cravate de Napoléon
©Jean-Marc Manaï,
Château de Versailles |
|
 |
Cette particularité
explique la ressemblance de certains portraits, comme
ceux de David. D'autres, comme ceux de Lefèvre,
sont moins réussis, car il ne put saisir l'homme
dans sa vie et utilisa surtout des gravures et de dessins.
Lefèvre étudia en fait les costumes de l'Empereur
portés par des mannequins dans son atelier. C'est
la raison pour laquelle l'Empereur semble si figée
dans ses toiles. Il est toujours reconnaissable mais plus
sûrement grâce à son costume qu'à
son visage. |
| |
MMF : Nous sommes
étonnés par le caractère somptueux
du costume du sacre de Napoléon. Son apparence
royale tranche avec l'aspect simple et militaire de cet
homme que vous avez évoqué. Y a-t-il une
explication ?
J.B. : Napoléon s'habillait habituellement en uniforme
de colonel de la garde impériale. En cela, il s'inspirait
d'une tradition prussienne inaugurée au XVIIIe
siècle par Frédéric-Guillaume et
Frédéric II, ses modèles militaires
et politiques. En définitive, il porta peu le costume
endossé à l'occasion de son couronnement
et de son mariage avec Marie-Louise. Ce costume rappelait
les vêtements portés par les rois de France
au moment de leur sacre. Par là, il revendiquait
et utilisait une tradition dont il modifiait en même
temps les symboles, puisqu'ils sont ceux de l'Empire. |
 |
MMF : Vous dîtes
qu'il favorisa la peinture comme instrument de propagande.
Napoléon eut-il une influence directe sur le style,
l'iconographie ou la raison d'être de la peinture
?
J.B. : Il semble que l'art napoléonien n'ait pas
bouleversé les modes de représentation picturaux.
Entre la fin du XVIIIe siècle et le début
de la période romantique (vers 1820), il y a une
certaine unité stylistique, une constante dans
le traitement de la matière picturale. La seule
rupture dans la peinture concernerait plutôt la
volonté d'y imposer son image.
Nous pouvons parler éventuellement d'une autre
rupture dans un domaine particulier, celui de la peinture
militaire. Dans les peintures du Baron Lejeune, dont plusieurs
toiles sont exposées à l'exposition, —
je pense à La Bataille de la Moskowa — nous
voyons pour la première fois apparaître le
soldat au combat. C'est l'expression d'un sentiment démocratique
apparu avec la Révolution française. L'image
du soldat au combat s'affirmera d'ailleurs au cours du
XIXe siècle jusqu'à prendre complètement
la place des généraux et des maréchaux,
les seuls à être représentés
jusque-là. Les prémices de cette évolution
se trouvent donc chez Lejeune. |
| |
 |
| |
 |
| |
MMF:Avez-vous
restauré un grand nombre d'œuvres pour cette
exposition ?
J.B. : Oui, un très grand nombre d'œuvres
ont été restaurées à cette
occasion. Toutes les peintures ont subi un examen de leur
surface picturale. La toile de Mme Auzou au sujet du mariage
de Marie-Louise a en particulier fait l'objet d'un travail
approfondi. Certaines pièces de mobilier ont dû
être démontées intégralement
pour intervenir au mieux. |
 |
 |
 |
▲Restauration
des meubles du Trianon.
©NAKAMURA Yutaka |
|
MMF: Pour terminer,
auriez-vous un message particulier à adresser au
public japonais qui se rendra à l'exposition ?
J.B.: Je pense que le public féminin qui visitera
cette exposition pourra être séduit par le
luxe et la préciosité des vêtements
portés par les femmes de cette époque. Ces
grands habits, de goût un peu antiquisant, marquent
une évolution intéressante dans l'histoire
de la mode et du costume. La porcelaine, bien représentée,
pourra certainement intéresser le public japonais.
Enfin, les reconstructions de décors qui montrent
la façon de vivre à l'époque susciteront
sans doute l'intérêt du public. |
 |
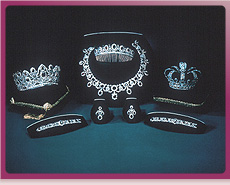 |
 |
 |
 Marie-Éienne NITOT Marie-Éienne NITOT
Parure de l'impératice Marie-Louise
©Musée Chaumet, Paris |
|
| |
 |
| |
| |
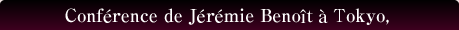 |
| |
| |
| dans le cadre
de l'exposition Napoléon
et Versailles : |
| |
| « L'Antiquité
et le goût bourgeois dans
le mobilier Empire à travers
les collections de Versailles » |
|
Date:
Lundi 10 avril 2006, à
10 h.
Lieu: Maison Franco-Japonaise,
Ebisu |
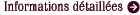 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
▲Antoine-Jean
GROS
Le général Bonaparte au pont d'Arcole,
le 17 novembre 1796(huile sur toile)
©Jean-Marc Manaï,
Château de Versailles |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3 décembre
2005-19 mars 2006 |
|
 |
| ■ |
Adresse |
| |
24, kyomachi,
chuo-ku, KOBE |
| |
 |
 |
| 8 avril-18
juin 2006 |
Musée
des Châteaux de
Versailles et de Trianon |
|
|